Assises nationales de la refondation : la sous-commission N°1 penche pour une transition de plus de trois ans et écarte les hommes politiques de son animation

Ce lundi 17 février 2025, la troisième journée des Assises Nationales de la Refondation a été marquée par des débats intenses et constructifs au sein de la sous-commission numéro 1, dédiée à la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Présidée par M. Idi Ango Omar, cette commission a abordé des enjeux cruciaux pour l’avenir du pays, avec une attention particulière portée sur la justice, l’équité et la participation de tous les acteurs sociaux. Elle a clôturé cette journée en abordant un point crucial ajouté en urgence à l’ordre du jour : la charte de la transition. Les débats ont révélé une forte tendance en faveur d’une transition excédant trois ans, ainsi qu’une méfiance marquée à l’égard des hommes politiques, jugés responsables des crises passées. Ces orientations, si elles sont adoptées, pourraient redéfinir en profondeur le paysage politique et social du pays.
Cohésion sociale et réconciliation nationale : deux piliers indissociables
Dès l’ouverture des travaux, les participants se sont penchés sur deux sous-thèmes étroitement liés : la cohésion sociale et la réconciliation nationale. M. Idi Ango Omar a souligné l’importance de l’équité et de l’égalité dans la construction d’une société unie. « Les citoyens doivent bénéficier des mêmes opportunités, que ce soit dans l’accès aux soins, à l’éducation ou à la sécurité. C’est la condition sine qua non pour renforcer la cohésion sociale », a-t-il déclaré.
Sur la question de la réconciliation nationale, les débats ont mis en avant la nécessité d’une justice équitable comme fondement d’une paix durable. Les participants ont insisté sur le fait que la réconciliation ne doit pas être un simple vœu pieux, mais un processus solide et inclusif. « Il ne s’agit pas de tourner la page sans régler les préjudices du passé. La justice doit jouer un rôle central pour éviter que les rancœurs ne resurgissent », a expliqué M. Omar.
Dans cette optique, la revalorisation du rôle des chefs traditionnels dans le règlement des conflits a été largement plébiscitée. Ces leaders communautaires jouent un rôle clé dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. La Commission a insisté sur la nécessité d'un véritable travail de justice et d'écoute pour répondre aux préjudices du passé sans tomber dans la vengeance. Par ailleurs, les femmes ont été identifiées comme des piliers dans la promotion d’une culture de la paix, notamment à travers leur implication dans l’éducation et les structures communautaires.
La paix : une quête permanente
Le troisième sous-thème abordé, celui de la paix, a été l’occasion de rappeler que la paix n’est pas un état statique, mais une quête permanente. Les participants ont souligné l’importance d’impliquer tous les acteurs de la société, des écoles aux administrations locales, pour enseigner et promouvoir la culture de la paix. Elle recommande la mise en place de comités permanents au niveau national et régional, ainsi que l'organisation de forums et d'ateliers regroupant les différents acteurs de la société. Les femmes, les chefs coutumiers, les enseignants et les responsables administratifs ont été identifiés comme des acteurs clés dans cette démarche. La sensibilisation et la prévention des conflits doivent être ancrées dans les pratiques quotidiennes pour favoriser un climat de paix durable.
La Charte de la transition : une question de durée et de gouvernance
En fin de journée, la commission s’est attelée à un quatrième point ajouté à l’ordre du jour : la charte de la transition. Deux aspects ont été largement débattus : la durée de la transition et le rôle des acteurs politiques. Sur la question sensible de la durée de la transition, une majorité des participants s'est prononcée en faveur d'une période excédant trois ans, sans toutefois en préciser la durée exacte. Seuls huit ont plaidé pour une transition limitée à trois ans.
Par ailleurs, concernant la gouvernance, les débats ont révélé une méfiance à l’égard des hommes politiques, jugés responsables des crises passées. « Les participants estiment que les politiques ne doivent pas animer cette transition, car ils sont à l’origine des événements du 26 juillet », a précisé M. Omar.
Les travaux de la commission se poursuivront demain avec la présentation d’un rapport provisoire en plénière. Ce document, fruit de quatre jours de débats passionnés, devrait servir de base pour les recommandations finales des Assises Nationales de la Refondation.
En conclusion, cette troisième journée a démontré la volonté des participants de construire un avenir fondé sur la justice, l’équité et l’inclusion. Reste à voir comment ces propositions seront traduites en actions concrètes pour garantir une paix durable et une véritable réconciliation nationale.
Abdoulkarim (actuniger.com)




 J'aime
J'aime 








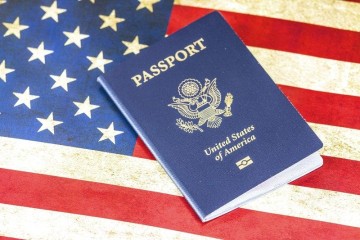


Si nous continuons à cultiver la cupidité, l’égoïsme et les pratiques qui nuisent à l’intérêt général, nous resterons enfermés dans un cercle vicieux. Le changement ne viendra pas de lois, mais d’une transformation collective des mentalités.
Il est essentiel de cultiver des valeurs telles que le patriotisme, la recherche du savoir, et le travail acharné, qui sont le fondement de toute réussite. Sans ces valeurs, les plus beaux textes les mieux rédigés resteront lettre morte.
En somme, le véritable changement commence par chacun de nous. C’est en changeant nos attitudes et en adoptant des valeurs positives que nous pourrons construire un avenir meilleur pour le Niger.
En résumé, bien que les Assises du Niger puissent apporter une certaine impulsion au dialogue national, il est crucial qu'elles s'orientent vers une réflexion plus profonde sur les causes systémiques des problèmes